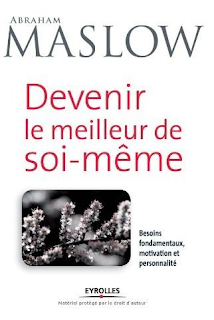Pieter Bruegel l'ancien (1525-1569) est un peintre narratif de la société et de ses fêtes, ce qu'on qualifie de genre mineur. Il n'est donc pas surprenant que l'un des tout premiers tableaux conservés ayant pour sujet le jeu soit ces jeux d'enfants peints en 1560. Représentant une foule éparses de joueurs absorbés à leurs jeux individuels ou collectifs, ce tableau est le plus commenté de l'épistémologie ludique.
La simultanéité des actions non concertées donne à la scène un air de cour de récréation qui aurait contaminé la société tout entière, et aussi loin que porte le regard, que ce soit à l'intérieur des maisons ou en extérieur, seuls ou en groupe, on ne voit que des personnages qui jouent. Or à la différence d'un carnaval, l'action n'a rien de concertée, et plus étrange encore le rire, traditionnellement associé au jeu, en est absent. Il est en outre bien difficile de lire un sourire sur les visages de ces enfants sans âge, dont les corps sont adultes mais les visages ronds rappellent clairement ceux de l'enfance. Chaque personnage poursuit son jeu sans qu'il soit possible de déterminer s'il en éprouve du plaisir.
Les jeux représentés ici sont les plus simples : on n'y voit seulement des jeux d'adresse, les jeux de hasard et de réflexion en sont apparemment absents. Il s'agit donc davantage de jouets, d'enfantillages, comme le prouve le titre du tableau. Dès lors, d'apparemment descriptive, cette scène acquiert une valeur symbolique : serait-ce une condamnation de la société où chacun gaspille en plaisirs superficiel le bref temps dont-il dispose sur terre ? Ou une critique du jeu, aliénation qui nous enchaîne tous et nous éloigne de nos aspirations réelles, menaçant d'envahir une société dont le siècle d'or a éloigné la crainte liée aux guerres, aux famines et aux maladies ? Que serait une société dont le travail aurait disparu au profit du seul jeu profane ? Dont les joueurs auraient oublié la mesure en même temps que le but, et dont ceux-ci joueraient désormais sans frein, sans retenue comme des fous de carnaval ou les envoutés des danses macabres, au mépris de leur salut et de leur âme ? A moins que notre vie n'ait été qu'illusion et que, tels des pantins ou des pions, nous jouions un jeu perpétuel qui nous dépasse ?
Le tableau, très ouvert, pose davantage de questions qu'il n'en résout. Peinture de la dernière période, on voit poindre derrière le dénombrement méticuleux des jeux des contemporains du peintre, la préoccupation lancinante du salut et des repères : où s'arrête la réalité, où commence le jeu ? Le jeu est-il soulagement des peines ou instrument de perdition ? Héraclite nous le rappelle mélancoliquement : "Le temps est un enfant qui joue."
Jeux d'enfants de Pieter Bruegel l'ancien, Kunshistorishes Museum de Vienne, 1560.