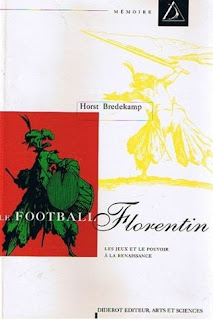Dans la préface à la
traduction française, l’auteur, Horst Bredekamp, se dit flatté que son ouvrage
paraisse en français, la langue de l’auteur de Le Pain et le cirque (Paul
Veyne), et qu’à son image il a tenté de faire une sociologie du jeu, ce que
laisse effectivement penser le sous-titre : les jeux et le pouvoir à la Renaissance.
Hélas, si les règles du jeu sont connues, H. Bredekamp ne nous en fait guère
profiter, sinon qu’à la différence du football on peut pousser le ballon du
point fermé. Plus problématique, à part décrire trois fois la même gravure et
insister sur les parades et les libéralités des Médicis qui organisaient ce
spectacle, à la fois élitiste et populaire au point d’être souvent présenté
comme l’essence de l’âme florentine, l’auteur ne fait que dans le descriptif et
l’anecdotique : n’importe qui ne pouvait se livrer à ce sport sans être
condamné par l’opinion publique, les anglais ont repris le jeu, l’interruption
inopportune d’une partie par un caporal de police faillit se solder par sa mise
à mort (« pour l’honneur des nobles, de la place et du jeu » p. 127),
etc.
On cherche en vain où se
situe cette sociologie du pouvoir tant les documents cités sont minces :
principalement trois gravures, quelques poèmes, des anecdotes. D’autre part,
aucun rappel du fonctionnement d’une cité italienne n’est fait, pas plus que de
la particularité de la famille Médicis comme mécène, de l’exercice du pouvoir
nobiliaire, de l’émergence de la bourgeoisie citadine à la Renaissance, pas
plus que d’explications des origines ou de la disparition du calcio autre qu’un
simple constat. Bref le lecteur n’a droit qu’à la description de la magnificence
de la fête, de la richesse des habits, de l’adresse dont faisaient preuve les
joueurs, du goût des dames pour ce spectacle, de l’importance des cérémonies
d’ouverture, etc. En dépit d’un grand nombre de notes et de références
bibliographiques, il semble que l’auteur, comme en témoigne la dédicace son
texte à un ami historien fan de football, se soit contenté d’un article
hypertrophié prétexte à un clin d’œil à la passion de son collègue. On se
demande donc ce qu’un éditeur français a pu trouver à ce texte banal et inintéressant,
sinon à partager sans doute le préjugé de l’auteur qui le porte à croire que le
thème footballistique suffira à lui procurer un lectorat.
Seule une érudition sporadique
sort parfois le lecteur de sa torpeur, sollicitant Thomas More pour une
métaphore footballistique du monde : « Dieu aurait pu transformer le monde en football, en y ajoutant certains
détails, et sauver ce football rond et roulant sur lequel l’homme marche et les
navires naviguent, pour le peuple pour qui il n’y a pas de repos, pas de
stabilité. » (p. 138). C’est bien mince et le sous-titre trompeur de
cette étude n’y a pas suffit, la rareté de citation de cet essai par l’épistémologie
ludique, autant que la possibilité de se le procurer encore aujourd’hui sous
cellophane à vil prix, montrant que l’éditeur n’est pas parvenu à ses fins. Un
livre parfaitement dispensable, qui manque complètement son ambition, celle d’une
anthropologie historique d’une fête locale.
Le
football florentin : les jeux et le pouvoir à la Renaissance
(1993) de Horst Bredekamp, Diderot 1995, 254 pages, épuisé.