Les années 80-90 ont été une période faste
pour la recherche où il suffisait de proposer un colloque pour que les
subventions affluent : conférenciers rémunérés et défrayés, actes publiés
à grand frais chez des éditeurs prestigieux. La recherche avait alors une physionomie
mercenaire, où l’on publiait non en fonction de ses propres travaux mais au
rythme des rétributions. Aujourd’hui que les conférenciers écrivent et
communiquent à leur charge, y compris en acquittant l’entrée des colloques qu’ils
contribuent à animer, on reste dubitatif devant cette somme de 40
communications d’une vingtaine de pages chacune. Bien entendu, aucun filtre d’un
comité scientifique, il s’agissait que tout le monde puisse avoir sa part du
gâteau. Le résultat est un ensemble de communications qui vont du XIVe au XVIIIe siècle, ce qui fait large pour la Renaissance, dont plusieurs ne font
même pas l’effort de traiter du jeu.
La faute à une introduction revancharde
contre les psychologues, psychanalystes et philosophes qui ont eu l’audace d’annexer
le sujet : « Mais à force de
parler du jeu, de l’homme ou de l’enfant,
ils finissent par oublier les jeux, les
hommes, les enfants. Les historiens des mentalités et des sociétés nous ont
appris, eux, à observer, à comparer, à décrire, avant de conceptualiser, même
si leur regard n’est pas non plus tout à fait innocent. Mais leur idée de la
société et de la sociabilité, de l’humanité et de l’enfance, des motivations,
des modalités et des effets de l’activité ludique, est solidement amarrée à l’intelligence
d’une époque, à la saisie intuitive et globale d’un paysage social déterminé, à
un sens ou à une pratique quasi-expérimentale des différences, des évolutions
et des changements. » (p. 5) On ne perçoit pas trop en quoi « la
saisie intuitive et globale » des uns diffère de cette des autres, d’autant
que cette diatribe rappelle précisément celle de Marcel Detienne, et à travers
lui des anthropologues, contre le refus de comparatisme des historiens, qui s’arrogent
ici le droit de comparer au seul prétexte qu’ils sont historiens.
Il faut reconnaître que la conclusion de l’ouvrage
assume parfaitement cette prétendue richesse de la micro-étude en présentant
sur 30 pages… le résumé successif des 40 communications de l’ouvrage. Il est
vrai que synthétiser des communications sans problématique, parfois strictement
descriptives (comme celle du tableau de Pieter Bruegel), sans rapport avec le
jeu (sur les poupées votives, le carnaval, le capitalisme, la mascarade, la
divination, etc.), ne traitant pas de la Renaissance (ex. : le jeu dans
les lettres de la marquise de Sévigné) ou encore sur des textes en latin, occitan,
espagnol, italien, ancien français sans qu’aucune traduction ne soit fournie (l’historien
est par essence polyglotte), relève du funambulisme. Le pire est que, lorsqu’enfin
ces historiens tentent de dégager une conclusion de leur communication, ils en
reviennent seulement à abonder dans le sens des « représentants patentés de l’intelligentzia parisienne, maîtres à
penser et surtout accapareurs de nos mass média » (p. 663, à savoir essentiellement
Freud, Huizinga, Caillois, Calvet et Cotta) et à ne répéter, malgré « la solidité et l’approfondissement des
connaissances historiques, la richesse et l’intelligence de maniement de l’appareil
documentaire utilisé, la méfiance salutaire » revendiqués que la caricature « de ces généralités ou de ces a priori aussi excitants pour des esprits superficiels que creux pour des
intelligences ouvertes » (p. 662). D’autant que le commentateur de
Bruegel passe à côté du sens du tableau, que le prétendu spécialiste de
Montaigne fait un contresens sur son œuvre, et que l’informatique rend rétrospectivement
pathétique les diverses tentatives des conférenciers pour traiter exhaustivement
les occurrences du jeu dans leur corpus.
Il ne faut pourtant pas en conclure que ce
colloque ne vaut rien, car l’on trouve au fil des pages quelques perles : « Parlant de la période des Saturnales, temps
de licence que l’on retrouve chez beaucoup de peuples et dont la durée et les
dates variaient, J. G. Frazer y voyait ne période intercalaire, destinée à y
mettre d’accord l’année lunaire et l’année solaire. Il s’agissait donc d’une
période en dehors de l’ordre régulier. Dans beaucoup de régions elle est
constituée de douze jours. » (p. 631). Comme les douze résultats des
dés, le jeu s’emparait autant de jours de la société toute entière. Il est
dommage qu’une fois encore l’histoire ne serve qu’à révéler des documents ou
des faits, souvent inédits et de première main, et que leur synthèse, quand ce
n’est pas leur analyse tout entière, restent ravalées à l’accessoire. Une
source d’informations hétéroclites dont l’intérêt est inversement proportionnel
au nombre de pages qui la constituent.
Les
jeux à la Renaissance
sous la direction de Philippe Ariès et Jean-Claude Margolin, Vrin 1982, 736
pages, 62.70 €.
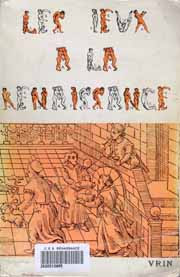

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire